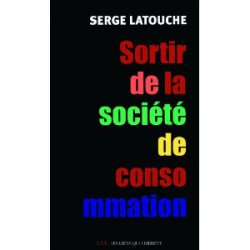Sortir de la société de consommation
Serge Latouche
Ce livre prône la construction d’une civilisation de sobriété choisie et d’autolimitation, alternative à l’impasse de la société de consommation. Il défend également la non-violence, la désobéissance civile, la désaffection, le boycott et les armes de la critique. Il met en avant le Sumak Kasai, le Bien-vivre des indigènes d’Amérique. Il affirme que la voie de la félicité passe par la sortie de l’économie et l’esprit du don.
Introduction : Le réveil des Amérindiens, autre voie et autre voix
Le 28 sept 2008, après avoir créé la 1ère université des savoirs indigènes, Evo Morales publie une nouvelle constitution qui se fixe comme objectif le Sumak Kausaï, le Bien-vivre, une rupture avec l’objectif de toujours vivre mieux, propre à notre civilisation occidentale. Il est défini par l’article 275 comme : l’ensemble organisé, durable et dynamique des systèmes économiques, politiques, socioculturels et environnementaux. En Equateur et en Bolivie, la nature a été reconnue comme sujet de droit, au grand dam des compagnies minières étrangères. « La nature ou Pachamama, là où la vie se réalise et se reproduit, a droit au respect de son existence, au maintien et la régénération de ses cycles vitaux… ». L’eau est déclarée « bien commun » et constitue donc un patrimoine inaliénable, accessible à tous et qui ne peut être privatisé. La conception industrialiste et prédatrice de la guerre contre la nature est abandonnée au profit de la recherche de l’autonomie, et de la souveraineté alimentaire et énergétique dans le respect de l’équilibre écologique.
Au Mexique, l’armée zapatiste a rejeté, dès sa première déclaration, la prise de pouvoir ; c’est une rupture dans la tradition latino-américaine. Interrogé le 2 février 1994, le sous-commandant Marcos déclare : « Nous voulons la prise de pouvoir ? Non ! Une chose à peine plus difficile : un monde nouveau… construire un monde où beaucoup de mondes aient leur place. Nous ne luttons pas pour la prise de pouvoir, mais pour la démocratie, la justice et la liberté. L’EZLN entend être une force politique qui n’aspire pas à la prise de pouvoir et ne soit donc pas un parti politique ; une force qui puisse organiser les demandes et propositions des citoyens. Avec la mondialisation économique, le lieu du pouvoir est désormais vide ; il ne sert donc à rien de conquérir le pouvoir. » En cela, et en refusant de se considérer comme une avant-garde, l’EZLN fait la critique de l’héritage marxiste et léniniste.
En 1996, le forum indigène a énoncé quelques règles : Servir et non se servir ; représenter et non supplanter, construire et non détruire, obéir et non commander, proposer et non imposer, convaincre et non vaincre.
1ère partie : sortir de l’impasse
La société de consommation repose sur la croissance sans limite. La « catastrophe productiviste » actuelle pose le problème de l’effondrement annoncé de la civilisation économique.
Ch. 1er : La catastrophe productiviste
Après le 4° rapport du GIEC en 2007, et son actualisation pour le sommet de Copenhague en mars 2009, nous savons désormais qu’il est trop tard : nous aurons 2°C de plus avant la fin du siècle, ce qui signifiera notamment la montée des eaux, des centaines de millions de réfugiés climatiques (jusqu’à 2 milliards selon certaines estimations , une pénurie d’eau potable… Ces catastrophes sont celles de l’anthropocène, c’est-à-dire qu’elles sont liées à l’activité humaine.
La catastrophe (Nakba, shoah) a à voir avec la notion d’effondrement (collapse) : une civilisation disparaît pour avoir détruit son environnement. Cf Joseph Tainter : les sociétés complexes tendent à s’effondrer car leurs stratégies de captage de l’énergie sont sujettes à la loi des rendements décroissants. Ainsi, l’île de Pâques, la civilisation maya, celle des vallées de l’Indus ou des Vikings du Groenland. La plupart des grands accidents sont dus à des infractions à la législation et d’incroyables négligences qui sont elles-mêmes dues à trois facteurs : la vanité, la cupidité et la volonté de puissance. L’aveuglement et l’arrogance des « savants/experts », favorisés par le culte de la science et la foi dans le progrès jouent un rôle complémentaire.
Chronique d’une catastrophe annoncée
Plusieurs avaient prévu tout cela : Cf le livre prémonitoire de Pierre Thuillier, « La grande implosion » ; Svante Arrhenius qui a découvert l’effet de serre dès la fin du 19° (« le développement a été explosif, nous courrons vers une catastrophe ») ; le rapport de 1972 du Club de Rome « Halte à la croissance ? » (La croissance infini est incompatible avec les fondamentaux de la planète) ; René Dumont en 1974 (« Si nous maintenons le taux actuel d’expansion de la population et de la production, le siècle prochain connaîtra l’effondrement total de notre civilisation » ; la déclaration de Wingspread en 1991 (sur les dangers des produits chimiques) ; l’appel de Paris en 2003 (sur les dangers sanitaires liés à la croissance économique) ; le Millennium ecosystem assessment Report de 2005, pour l’ONU et s’appuyant sur les travaux de 1360 spécialistes (la destruction de nos écosystèmes compromet nos objectifs économiques, sociaux et sanitaires).
Nous sommes aujourd’hui entre le krak et le crash, et nos « responsables » politiques sont plus prompts à sauver les banques que la banquise, notre niveau de vie que celui des océans. Pourtant, les spécialistes parlent de 6° extinction des espèces. La 5° s’est produite au Crétacé (65 millions d’années) et avait vu la fin des dinosaures à la suite du choc d’un astéroïde géant sur la terre. Mais aujourd’hui, il y a trois différences : les espèces végétales et animales dont l’estimation va de 3 à 30 millions, disparaissent à une vitesse de 50 à 200 par jour, soit un rythme 1000 à 30.000 fois supérieur à celui des hécatombes des temps géologiques précédents. Deuxièmement, l’humain est directement responsable de cette « déplétion » du vivant. Enfin, il pourrait bien en être la victime. Dominique Belpomme évoque la fin possible de l’humanité vers 2060, par stérilité généralisée du sperme masculin, sous l’effet des pesticides et autres polluants. L’astronome royal Sir Martin Rees ne donne à l’humanité qu’une chance sur deux de survivre au 21° siècle . Sir James Lovelock estime qu’il est probable que seulement 500 millions de personnes survivent autour des zones polaires . On peut se montrer sceptique par rapport à ces travaux de futurologie menés par des individus, mais ceux du Club de Rome sont plus solides, car ils s’appuient notamment sur ceux du Massachusetts Institute of Technology qui a construit un modèle schématique (world 3), testé sur plus d’un siècle et pour l’ensemble du monde. Deux aspects renforcent sa crédibilité : l’indépendance des variables et la prise en compte des boucles de rétroaction. Or, dans son dernier rapport, il estime que tous les scénarios qui ne remettent pas en cause les fondamentaux de la société de croissance, aboutiront à son effondrement. Il situe le premier vers 2030 du fait de la crise des ressources non renouvelables ; le 2° vers 2040 du fait de la crise de la pollution, et le 3° vers 2070 du fait de la crise de l’alimentation. Un seul scénario est crédible, celui de la sobriété.
Les causes : le totalitarisme productiviste
On peut appeler « ex-croissance » la croissance qui dépasse l’empreinte écologique soutenable et qui correspond, en tous cas en Europe, à la surconsommation. Ce désir de croissance infinie a commencé au moins vers 1750 avec le capitalisme occidental et l’économie politique. C’est le rêve d’Adam Smith partagé par les Lumières, d’un enrichissement de tous. On trouve dans son livre « La richesse des nations », ce que les économistes appelleront le « trickle-down effect », l’effet de diffusion, l’idée que l’accroissement de la richesse des uns, finit toujours par avoir des retombées sur tous, individus et pays. La généralisation de la machine à vapeur et de l’usage du charbon vers 1850, donnera de l’essor à tout ça. Mais ce n’est qu’à partir de 1950 avec l’invention du marketing et de la société de consommation, que le système peut libérer tout son potentiel créateur et destructeur. Les trois piliers du système consumériste sont la publicité qui crée sans fin le désir de consommer, le crédit qui fournit les moyens de le faire, même à ceux qui n’en ont pas les ressources, grâce à l’endettement, et l’obsolescence programmée qui assure le renouvellement de la demande.
Comment fonctionne la croissance ? Prenons un exemple : Une algue verte double chaque année de surface et finit par couvrir un étang en 30 ans. Au bout de 24 ans, elle n’en recouvre que 3%, et quand elle a couvert la moitié de l’étang, nous sommes à la veille du recouvrement complet. Avec un taux de croissance de 10%/an, la Chine double son PNB en 7 ans, et le multiplie par 736 en un siècle. Avec un taux à 3,5% (France de 1949-59), on le multiplie par 31 en un siècle, par 961 en deux siècles et par 16.000 en trois siècles. A 2%, taux qui nous présenté comme le minimum, le PIB est multiplié par 160 millions de milliards en 2000 ans. Or, l’homo sapiens-sapiens n’a que 56.000 ans.
Si la croissance engendrait le bonheur, nous devrions être depuis longtemps au paradis. Mais en fait, cette croissance est d’abord celle du prélèvement des énergies fossiles et des ressources non-renouvelables, le développement des déchets et des destructions.
Ch.2 : Y aura-t-il une vie après le développement ?
La décroissance est un slogan provocateur pour signifier la nécessité d’une rupture avec la société de croissance.
La rupture des mots : décoloniser l’imaginaire
Le développement comme mythe, rassemble aujourd’hui tous les espoirs d’un développement économiquement efficace, écologiquement soutenable, socialement équitable, démocratiquement fondé, et culturellement diversifié. Bref, le merle blanc qui n’existe pas.
Le « développement durable » est un pléonasme au niveau de la définition, car le développement est déjà un self-sustaining growth (croissance durable par elle-même) ; et un oxymore dans le contenu, car le développement n’est, dans la réalité, ni durable, ni soutenable. Le problème n’est pas le durable et le soutenable qui renvoient aux principes de responsabilité et de précaution du philosophe Hans Jonas, mais le « développement » qui les violent allègrement, cf l’amiante, les pesticides, etc… Le développement durable a aujourd’hui son double, la croissance verte.
La rupture des mots
Le « développement durable » est souvent représenté par trois cercles séparés figurant l’économique, le social et l’environnement. Or, cela suppose une autonomie de chacun qui n’existe pas. On dit, par ex, que le coût de l’énergie ne représente que 5% du PIB et qu’il ne faut donc pas s’inquiéter, mais sans ces 5%, les 95% restant n’existeraient pas.
La question pour nous, n’est pas de substituer une bonne économie à une mauvaise, mais de sortir de l’économie, car elle est une religion. On devrait parler d’a-croissance comme on parle d’a-théisme ; il faut devenir des athées du développement de tout et n’importe quoi, car c’est un état d’insatisfaction généralisée qui définit en fait la société de croissance comme le contraire d’une société d’abondance.
Il s’agit de fixer des règles qui encadrent et limitent le déchainement de l’avidité des agents économiques, notamment par le protectionnisme écologique et social, la législation du travail, et la limitation de la taille des entreprise.
Sortir de l’imaginaire économique implique des ruptures :
Karl Polanyi voyait dans la marchandisation des trois marchandises fictives : le travail, la terre et la monnaie, la base du « marché autorégulateur ». Il faut maintenant les démarchandiser, notamment en favorisant des entreprises mixtes où l’esprit du don et la recherche de la justice tempèrent l’âpreté du marché.
Nous proposons un « cercle vertueux » de sobriété choisie en 8 R : Réévaluer, reconceptualiser, restructurer, relocaliser, redistribuer, réduire, réutiliser, recycler. Ils sont interdépendants et peuvent permettre d’enclencher une autre dynamique de civilisation.
Au niveau de la mise en œuvre, nous proposons un programme en 10 points :
1. Retrouver une empreinte écologique soutenable
2. Réduire les transports en internalisant les coûts par des écotaxes appropriées
3. Relocaliser les activités
4. Restaurer l’agriculture paysanne
5. Réaffecter les gains de productivité en réduction du temps de travail et en créations d’emplois
6. Relancer la « production » de biens relationnels
7. Réduire le gaspillage d’énergie d’un facteur 4
8. Restreindre fortement l’espace publicitaire
9. Réorienter la recherche technoscientifique
10. Se réapproprier l’argent.
Le réseau des « villes en transition » avec son concept de résilience (capacité d’un écosystème à s’adapter au changement de son environnement) est très proche de cela.
Dans l’immédiat, il faut juguler la crise en encadrant l’activité des banques et de la finance. Il faut recloisonner le marché financier mondial, refragmenter les espaces monétaires, annuler la titrisation des crédits, sans doute supprimer les marchés à terme, revenir à des systèmes plus classiques et simples d’assurance, fermer les bourses.
Il faut aussi se réapproprier la monnaie en réintroduisant de la pluralité : une monnaie pour les échanges de proximité et sur laquelle on ne peut spéculer ; une monnaie pour les échanges anonymes externes dont on limite et contrôle l’usage.
La réponse tirée de l’expérience écologique est que si la spécialisation permet d’accroître les performances dans un domaine, elle fragilise la solidité de l’ensemble. Au contraire, la diversité améliore la résistance et les capacités d’adaptation. Réintroduire les jardins potagers, la polyculture, l’agriculture de proximité, la permaculture, les AMAP, les petites unités artisanales, multiplier les sources d’énergie renouvelables… renforce la résilience.
Le développement et la croissance ne sont ni durables ni soutenables, car ils reposent sur une logique d’illimité. « Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou ou un économiste ».
Annexe : sur la traduction du mot croissance
Pour décroître, il faut décroire. On peut employer « decreasing growth », shrinking, declining, downsfhifting – decrescendo – swadeshi-sarvodaya : amelioration des conditions sociales pour tous – bamtaare : être bien ensemble – sumak kausai : bien vivre
2ème partie : La voie de la félicité : sortir de l’économie
Ch.3 : Esprit du don, économie de la félicité et décroissance
L’objectif proclamé de la modernité est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. D’après l’indice de félicité (happy planet index) mis en avant par l’ONG britannique New Economics Foundation en 2009, c’est le Costa Rica qui est en tête, puis la République Dominicaine, la Jamaïque et le Guatemala ; les USA sont 114°. La raison en est que la société dite de développement repose sur la production massive de la déchéance, la dégradation des marchandises, l’accélération du jetable qui devient rebut, comme des humains qui deviennent chômeurs, SDF…
C’est l’effet de déréliction qui en théologie désignait la situation de ceux à qui la grâce avait manqué. En Italien, les disgraziati sont les malchanceux, car dans cette société, il faut être gagnant et donc un peu tueur, sinon on est déchu. Cela crée de l’anxiété.
Aujourd’hui, l’oikos n’est plus la polis (la cité), mais l’oikuméné, c’est-à-dire toute la terre habitée. L’économie, par son hubris (démesure), est sortie de l’ordre du nomos (règle, loi) et donc du politique. Avec ses prétendues lois, l’économie se revendique comme physiocratique (soumise au pouvoir de la nature). Or, avec les Grecs, nous savons que les sociétés n’appartiennent pas à la phusis (la nature), mais bien au nomos. La science de la bonne vie, de la joie de vivre, Aristote ne l’appelle ni l’économique, ni la chrématistique(la recherche du profit pour lui-même), mais l’éthique. Il faut sortir de l’homo oecumenicus, car il n’est pas seulement un atome calculateur, il est socialement produit, invité dans la logique de la triple obligation du don : donner, recevoir, rendre. C’est la loi de la réciprocité qui est la socialité primaire, celle de la famille, du voisinage et des réseaux relationnels. Dans « l’économie de la félicité » forgée en Italie, l’esprit du don est un antidote à l’esprit mercantile et l’obsession du profit.
Esprit du don et société de décroissance
Cet esprit est nécessaire à la construction d’une société de décroissance et présent dans les 8 « R ».
Réévaluer : substituer aux valeurs de la société marchande (concurrence exacerbée, chacun pour soi, accumulation sans limite) et la mentalité prédatrice, les valeurs de l’altruisme, la réciprocité, la convivialité et le respect.
Reconceptualiser : La vraie richesse est faite de biens relationnels fondés sur la réciprocité, le partage, l’amour…
Dans les 8 « R », on retrouve le primat du don essentiel : celui de l’être. Face à cela, nous voyons l’arrogance insensée de l’artificialisation du monde et des projets de transhumanité liés aux nanotechnologies, biotechnologies, technologies de la communication…
Dans son article de 1924, Marcel Mauss préconisait de revenir aux vieux concepts grecs et latins de caritas (charité), de philia (amitié) nécessaire à la communauté (koinomia) qui est l’essence de la cité. C’est fondamental pour conjurer la rivalité mimétique et l’envie destructrice qui menacent toute société démocratique. Articuler don vertical et don horizontal est au cœur du projet de démocratie écologique holiste (qui englobe tous les domaines). Cela suppose de penser une forme d’autotranscendance, de spiritualité laïque.
L’économie de la félicité et la décroissance
Nous retrouvons le vieux débat scolastique des universaux au Moyen-Age : l’économie est-elle une essence ou une catégorie historique ? Elle a été inventée avec la modernité. L’oeconomie d’Aristote n’est pas notre économie qui correspond mieux à ce qu’il appelait la chrématistique, l’accumulation de la richesse pour elle-même. Avec Adam Smith, tout ce qui fait la joie de vivre ensemble est retiré du domaine de l’économie, et avec Hobbes, la notion de richesse est limitée au bien matériel. Le bonheur attendu de la consommation est séparé du bonheur des autres qui, contrairement à la richesse matérielle, se multiplie en se partageant. La vraie richesse tient d’abord à la quantité, la qualité et la variété des services dont nous disposons et donc de nos relations.
Cf projet d’économie civile de Luigino Bruni qui se rattache à la tradition aristotelicienne faisant la critique de l’individualisme. Dans la tradition scolastique, de Saint Thomas à Jacques Maritain, la personne est l’être en relation, qui n’est lui-même qu’en relation avec les autres, alors que l’individu subsiste en lui-même, il est autosuffisant. Or, dans la tradition d’Adam Smith, l’économie est celle de l’individu. En Occident, le bonheur est réduit au bien-être matériel mesuré par la consommation individuelle.
Contre le risque communautaire, la modernité a développé un projet « immunitaire », c’est-à-dire sans le munus, sans le partage de la « charge » qui permet de « changer ». Munus se rattache à la racine indoeuropéenne méi qui signifie (é)changer, et désignera en latin la charge, notamment officielle.
Le bien relationnel est un 3° bien à côté des biens privés et publics.
Conclusion
L’économie de la félicité véhicule, malgré son apport, une ambiguïté en laissant ouverte la voie d’un panéconomisme, d’une économie qui envahit tous les domaines de la vie. Retrouver le sens de la mesure, n’est-ce pas sortir de l’obsession du mesurable ?
Ch.4 : la décroissance est-elle la bonne nouvelle d’Ivan Illich ?
Les thèmes « décroissants » de la pensée Illich/Dupuy
L’insoutenabilité du développement et de notre mode de vie
La croissance et le développement font de tous des « intoxiqués nécessiteux ».
La contre-productivité
La corruption du meilleur engendre le pire (Illich) ; au-delà de certains seuils, les effets négatifs l’emportent, cf la médecine qui rend malade, l’école qui rend ignorant, le développement qui appauvrit. Pour le transport, Dupuy a calculé que si l’on intègre dans le temps de déplacement l’immobilité dans les embouteillages, le temps passé au travail pour payer la voiture, l’assurance…la vitesse qu’il appelle « généralisée » ne dépasse pas 6km/h, soit celle du piéton.
La disvaleur
C’est la perte qui ne peut s’estimer en termes économiques, par exemple perdre l’usage de ses pieds parce que l’on ne marche plus, grossir parce qu’on mange trop ou/et mal.
La colonisation de l’imaginaire
Le problème de base est que l’économie transforme l’abondance naturelle en rareté par la création artificielle du manque et du besoin illimité à travers l’appropriation de la nature et sa marchandisation. Les OGM sont la dernière illustration du phénomène de dépossession des paysans de la fécondité naturelle des plantes au profit des firmes agroalimentaires. L’abondance moderne est aussi une création artificielle de l’économie de la croissance. « Pour s’infiltrer dans le langage, l’homo oeconomicus a adopté deux méthodes qui rappellent, l’une l’action du rétrovirus VIH (la destruction des défenses immunitaires mise en œuvre à l’école) et l’autre les moyens employés par les trafiquants de drogue (la création de nouveaux besoins par la publicité) » (Majid Rahnema).
L’autolimitation des besoins
La société autonome est celle qui saura autolimiter les besoins ; c’est la seule voie pour échapper à l’écofascisme menaçant. Il faut faire disparaître le besoin obsessionnel d’aller toujours plus loin, plus vite et plus souvent.
La convivialité
Elle vise à retisser le lien social détricoté par « l’horreur économique » ; elle réintroduit l’esprit du don à côté de la loi de la jungle et renoue avec les vieux concepts de caritas (charité), philia (amitié) et koinomia (communauté) qui sont l’essence de la cité.
Illich analyse certains outils comme conviviaux : la bicyclette, la machine à coudre ; alors que d’autres outils sont destructeurs, quelle que soit l’utilisation : les autoroutes, les systèmes de déplacement à grande distance, l’exploitation minière ouvert. L’outil destructeur accroît l’uniformisation, la dépendance, l’exploitation et l’impuissance.
Catastrophisme éclairé et pédagogie des catastrophes
Les dysfonctionnements inéluctables de la Mégamachine (crises, pannes, risques techno majeurs) sont sources de souffrance, mais aussi l’occasion de prises de conscience et remise en cause. Cette pédagogie des catastrophes rejoint l’heuristique de la peur de Hans Jonas qui affirme qu’il vaut mieux prêter attention à la prophétie du malheur qu’à celle du bonheur, car la politique de l’autruche est suicidaire. Pour Dupuy, « la catastrophe a ceci de terrible que l’on ne croit pas qu’elle va se produire, alors même qu’on toutes les raisons de savoir, mais qu’une fois qu’elle s’est produite, elle apparaît comme relevant de l’ordre normal des choses ; elle devient banale. »
La paternité contestée
Les bases théoriques et la mise en œuvre de l’homo oeconomicus sont critiquées par la sociologie de Durkheim et de Mauss, par l’anthropologie de Polanyi et Sahlins, la psychanalyse d’Erich Fromm et Gregory Bateson. On peut se tourner dès les années 1960 vers André Gorz, Françoise Partant, Jacques Castoriadis et Ivan Illich.
La conscience des limites physiques de la croissance économique remontent sans doute à Malthus, mais son fondement scientifique vient de Sadi Carnot et sa 2ème loi de thermodynamique : les différentes formes de transformations de l’énergie (chaleur, mouvement…) ne sont pas totalement réversibles, en raison du phénomène de l’entropie qui a des conséquences sur l’économie car elle repose sur ces transformations. La question de l’écologie au sein de l’économie n’est posée que dans les années 70 avec le roumain Nicholas Georgescu-Roegen qui tire de la loi de l’entropie les implications bio-économiques déjà pressenties dans les années 1940-50 : En adoptant le modèle de la mécanique classique newtonienne, l’économie exclut l’entropie, c’est-à-dire l’irréversibilité du temps et des transformations de l’énergie et de la matière. Pratiquement, elle exclut la prise en compte des déchets et de la pollution, les lois de la biologie et de la chimie et de la physique. La véritable économie se déroule dans une biosphère de nature entropique qui fonctionne dans un temps fléché. De là l’impossibilité d’une croissance infinie dans un monde fini et la nécessité d’une bioéconomie, c’est-à-dire d’une économie pensée dans la biosphère. La décroissance est alors, non pas une utopie, mais une matrice d’utopies, non un programme politique, mais un schéma pédagogique. On peut dire aussi qu’elle est une utopie dans le sens d’une source d’espoir et de rêve, car, « sans l’hypothèse d’un autre monde possible, il n’y a pas de politique ; seulement la gestion administrative des humains et des choses. » (Geneviève Decrop). « La civilisation capitaliste va inexorablement vers son effondrement catastrophique… il creuse sa propre tombe et celle de la civilisation industrielle dans son ensemble. » (A. Gorz Capitalisme, socialisme, écologie). Face à cela, la Mégamachine se transforme en appareil militaire répressif.
Conclusion
Il nous faut retrouver la sagesse de l’escargot, emblème de la décroissance. « L’escargot construit la délicate architecture de sa coquille en ajoutant l’une après l’autre des spires toujours plus larges, puis il cesse et commence des enroulements cette fois décroissants. C’est qu’une seule spire encore plus large donnerait à la coquille une dimension seize fois plus grande. Au lieu de contribuer à son bien-être, elle le surchargerait. » (A.Gorz Le genre vernaculaire).
Ch.5 : Le défi de l’éducation à la décroissance
« … dès l’enfance, vulgarisant, au nom de la rentabilité, un élevage concentrationnaire où, parqués de 25 à 30 par classe, les écoliers se trouvent crétinisés par les principes de compétition et de concurrence, soumis aux lois de la prédation, initiés au fétichisme de l’argent, confits par la peur de l’échec, infestés par l’arrivisme… » (Raoul Vaneigem « Pour l’abolition de la société marchande » Payot 2002).
En 2008 en Belgique, 9 élèves sur 10 dans le Secondaire, ignorent les causes du réchauffement climatique. Des chercheurs espagnols ont montré sur 60 manuels, des erreurs, des inexactitudes, des contrevérités concernant ce sujet. En 2009, 41% des étasuniens pensent que le réchauffement climatique est exagéré… L’offensive contre le GIEC a porté des fruits, alliée à la volonté très répandue de mettre la tête dans le sable. On peut y rajouter l’imposture du capitalisme vert (Naomi Klein La stratégie du choc ; Actes sud 2008).
Le paradoxe du droit à l’éducation pour tous
La mondialisation/globalisation est la société de croissance devenue universelle. Elle se reproduit à travers une institution censée éduquer : l’école (au sens large). L’effet pervers du droit à l’éducation pour tous (cf : « la corruption du meilleur engendre le pire ») a été de détruire toutes les autres formes de construction des sujets sociaux en monopolisant la divulgation des savoirs et en éliminant toute alternative. Car toutes les sociétés ont eu des formes diverses d’éducation pour tous. Le nôtre a été un puissant véhicule de colonisation du monde.
Comment se fait l’éducation ?
L’école de la vie a toujours pris une place importante à côté de la vie à l’école. Cela va de l’école de la rue jusqu’au bourrage de crâne dans les familles aisées en passant par l’apprentissage d’un métier.
Chez les Anciens, la formation du citoyen, la paideia (éducation des enfants), passe d’abord par son édification. Il faut discipliner l’hubris, la démesure, maîtriser les passions tristes (avidité, soif de pouvoir, égoïsme, envie effrénée…) et canaliser les énergies dans le sens de l’harmonie et de la beauté. Mais aujourd’hui, à quoi peuvent éduquer les murs de nos villes, dans un urbanisme laid et sans âme, avec une publicité agressive et omniprésente, l’invasion de la propagande politique. Sans compter que es parents ont abandonné leur rôle d’éducateur. Les enfants étasuniens passent maintenant plus de temps devant la TV qu’à l’école où des sponsors paient des fournitures scolaires et vont jusqu’à diffuser des émissions publicitaires dans l’enceinte des écoles. C’est une lobotomisation des cerveaux, une colonisation de l’imaginaire. Le grande question est : l’école doit-elle préparer le jeune à la société telle qu’elle est ou telle qu’elle devrait être ? Doit-elle former des travailleurs « employables » et donc des consommateurs disciplinés ? Est-elle l’école de la guerre économique qui fabrique des tueurs, parcellise les savoirs et donc empêche de com-prendre (prendre ensemble), où l’on évacue de fait la notion de responsabilité ?
Résister à l’Absurdistan
Le projet émancipateur des Lumières a engendré l’immondialisation qui réduit l’édification au formatage et à la manipulation-fascination dans une société du spectacle et de l’éphémère. La première révolution doit être culturelle ; c’est plus difficile que les révolutions politiques, car nous sommes toxicodépendants de la société de croissance. Nous avons besoin d’une cure de désintoxication. Pour cela, il faut rompre les chaînes de la drogue ; les trafiquants étant les sociétés transnationales et les pouvoirs politiques à leur service.
Illich parlait de techno-jeûne ascétique ; l’askesis en Grec, est un entrainement de nous-mêmes pour voir de quoi nous sommes capables de nous passer, et pour nous persuader que nous sommes libres. Pour cela nous avons besoin de la vertu. C’était aussi la vision de Gandhi, le Naï Teleem, l’éducation à l’autonomie comme outil de libération : il s’agit de subvenir à ses besoins grâce à la connaissance et la maîtrise des techniques de fabrication des objets usuels pour que tout le monde puisse accéder à un niveau de vie satisfaisant.
3ème partie : Autres voix et autres voies
Pour construire l’autre monde de sobriété choisie et d’abondance frugale, il faut repenser le politique et sortir du prêt-à-penser de toutes les gauches. L’une des raisons de la faillite du socialisme est la volonté hégémonique d’un discours et d’un modèle, notamment la pensée unique du matérialisme historique, dialectique et scientifique. Il faut revenir aux voix du premier socialisme.
Ch.6 : Castoriadis, penseur de la décroissance
« Il n’y a pas seulement la dilapidation irréversible du milieu et des ressources non remplaçables, il y a aussi la destruction anthropologique des êtres humains transformés en bêtes productrices et consommatrices, en zappeurs abrutis. » (Castoriadis, Une société à la dérive).
Décroissance, autonomie et démocratie écologique
L’autonomie est le projet d’une société de décroissance. Cela signifie se donner ses propres lois, mais n’implique pas que la liberté soit sans limite. Il s’agit de faire l’apprentissage d’une soumission non servile à la loi que l’on s’est donnée, la soumission servile étant l’apprentissage de la tyrannie. Castoriadis aimait la paideia (éducation, pédagogie) du citoyen libre, capable de se donner des lois et d’y obéir. Chez lui, l’autonomie débouche sur la démocratie.
Le mythe occidental (Les Lumières) repris par Marx, voit dans la technique un moyen de l’émancipation (et donc de l’autonomie) de l’humain par rapport au règne de la nécessité ; alors que pour Illich, seul l’outil convivial, simple et maîtrisable, renforce l’autonomie. Cette divergence est au cœur des débats sur le développement, car celui-ci prétend émanciper l’humain par la technique, alors que le plus souvent elle l’asservit et au final l’appauvrit.
Ce n’est pas une opposition aveugle au progrès, mais au progrès aveugle. Le culte de la science est de moins en moins tenable, surtout quand elle est mise sur le marché en tant que technoscience à consommer (et censée apporter le miracle au changement climatique). Il faudrait décréter un moratoire sur l’innovation technoscientifique pour la réorienter.
La décolonisation de l’imaginaire
Il faut le faire, avant que le changement du monde ne nous y condamne dans la douleur. Pour Castoriadis, il faut une nouvelle création imaginaire dans laquelle les valeurs économiques ne seraient plus centrales. Il faut « abandonner l’idée que la seule finalité de la vie est de produire et de consommer davantage ; il faut abandonner l’imaginaire capitaliste d’une expansion illimitée. » (Castoriadis). C’est une révolution culturelle par rapport à l’idéologie de la croissance et du développement.
Comment en sortir ?
Comment sortir de la « crétinisation civique » et de la drogue de la croissance ? Il faut désirer être libre. On ne transforme ni par des lois, et encore moins par la terreur. Il faut dénoncer l’agression publicitaire ; c’est peut-être le point de départ de la contre-offensive ; « ce système fragile perdure seulement par le culte de l’envie. » (Jacques Séguala). Le système, écrit Castoriadis, ne fait pas que manipuler ; beaucoup de gens se dépolitisent, se privatisent, se tournent vers leur petite sphère « privée » et le système leur en fournit les moyens. La décolonisation sera un long processus d’auto-transformation ; seule une crise peut accélérer les choses. Une révolution est nécessaire, un changement de culture, du droit et des rapports de production.
La mise en œuvre d‘un projet politique obéit plus à l’éthique de la responsabilité qu’à l’éthique de la conviction. La politique n’est pas la morale et le responsable doit passer des compromis avec l’existence du mal. La recherche du bien commun n’est pas celle du bien tout court, mais plutôt celle du moindre mal. Pour autant, le réalisme politique ne consiste pas à s’abandonner à la banalité u mal, mais bien à le contenir dans l’horizon du bien commun. En ce sens, même radicale et révolutionnaire, toute politique ne peut être que réformiste et doit l’être, sous peine de sombrer dans le terrorisme. Ce nécessaire pragmatisme de l’action politique ne signifie pas une renonciation aux objectifs de l’utopie concrète. Le potentiel révolutionnaire de celle-ci n’est pas incompatible avec le réformisme politique dès lors que les compromis inévitables de l’action ne dégénèrent pas en compromission de la pensée.
La société de décroissance ne peut se concevoir sans sortir du capitalisme, mais ce processus n’est pas simple, car l’élimination des capitalistes, l’interdiction de la propriété privée des biens de production, l’abolition du rapport salarial ou de la monnaie plongeraient dans le chaos et ne seraient possibles qu’avec un terrorisme massif, et ne suffirait pas à abolir l’imaginaire capitaliste. « Il y a dans le Marxisme, l’idée absurde que le marché comme tel, la marchandise comme telle, personnifient l’aliénation. Or, dans une société complexe, les rapports humains sont médiatisés ; dans le cadre économique, cette médiation s’appelle le marché. Et il ne peut exister sans moyen impersonnel d’échange ; la monnaie remplit cette fonction. Par contre, on peut lui retirer l’une de ses fonctions propre au capitalisme, celle d’instrument d’accumulation individuelle de richesses et d’acquisition de moyens de production. En tant qu’unité de valeur et de moyen d’échange, la monnaie est une grande invention. » (Castoriadis).
Reste la question : Quelles forces sociales portent une alternative ? On ne peut plus dire que c’est le prolétariat ; la transformation exige la participation de toute la population
Ch.7 : Utopie méditerranéenne et décroissance
Il faut lutter contre l’omnimarchandisation, la macdonaldisation et la cocacolonisation de la planète.
La décroissance, un projet méditerranéen ? « La Raison, naquit sur les rives de la Méditerranée qui avait été le berceau des Dieux ; elle y œuvra pendant des siècles dans l’Harmonie… Puis elle s’empara de la Science et de la Technique, produisit le Nécessaire et le scintillant Superflu, en fit commerce et dédivinisa le monde qu’elle domina. » (Raffaele La Capria) Il y a eu une opération de méconnaissance de l’être au profit d’une artificialisation du monde et d’une élimination de la phronésis, la raison raisonnable. L’efficience économique résulte de l’application instrumentale érigée en absolu. Mais aujourd’hui la mégamachine technoéconomique occidentale risque de se fracasser contre le mur de la démesure (l’hubris). Nous sommes au défi d’une métanoia, d’une conversion.
Comme l’ont montré Erich Fromm et Wilhelm Reich, le capitalisme, l’économie et le phantasme de la croissance infinie sont patricentriques et phallocratiques. La société de décroissance sera féministe.
Conclusion
Il faut revenir à une vie active faite d’exercices physiques et pas seulement à la gymnastique ; à une alimentation simple et non plus industrielle ; lutter contre l’abus de viande. Le fast-food en est le symbole : « des producteurs mal payés + une énergie peu chère + un bas coût de transport + une transformation par des prolétaires étrangers + des impacts environnementaux et sanitaires non comptabilisés = une alimentation « moderne » bon marché pour des consommateurs occidentaux pressés. » (Yves Cochet) Manger est en fait un acte politique.
4ème partie : Une issue
Il faut saisir le kairos, le tournant favorable
Ch. 8 : La décroissance est-elle la solution à la crise ?
Il y avait une crise culturelle depuis mai 68, une crise écologique depuis 1972 et le 1° rapport du Club de Rome, une crise sociale depuis 1986 et la politique ultralibérale Reagan/Thatcher, une crise financière avec la bulle US des subprimes depuis l’été 2007. Il s’agit du prolongement de la crise du mode de régulation keynéso-fordiste commencée en 1974. Aujourd’hui, toutes les crises se cumulent ; cette crise du « turbo-capitalisme » est une crise de civilisation. Elle pourrait nous offrir l’occasion de résoudre toutes les autres.
L’opportunité de la crise
En 1978, François Partant écrivait « Que la crise s’aggrave » ; il voyait dans la crise le seul moyen d’éviter l’autodestruction de l’humanité. Dans les années 90, on dit que l’économie va bien, mais que les gens vont mal, on parle d’une croissance dont les coûts pour la population sont supérieurs aux bénéfices. Il vaut mieux une décroissance choisie à une décroissance subie, car il n’y a rien de pire qu’une société de croissance sans croissance ; elle peut mener à l’écofascime et la barbarie.
Toute la Gauche s’est laissée séduire par le mythe de la tarte qui grossit indéfiniment ; elle a choisi de collaborer à l’accumulation capitaliste. La croissance est ce qui rend supportable le capitalisme et il faut en revenir aux fondamentaux du socialisme, sans oublier cette fois la nature. En 1848, la tarte était 30 à 50 fois moins grosse et pourtant Marx comme John Stuart Mill pensaient déjà que le problème était la répartition plus que la production.
Nous devons construire une société écosocialiste plus juste et démocratique, d’abondance frugale fondée sur l’autolimitation des besoins.
Changer de logiciel : une piste pour l’avenir
Ni la crise éco et financière, ni la fin du pétrole ne sont nécessairement la fin du capitalisme. Il peut fonctionner avec une grande rareté de ressources naturelles, du développement durable, de la croissance verte ; il peut continuer à croître pendant que les famines et les guerres se multiplient, car le capitalisme croît aux dépens de la société. Les statistiques nous trompent en n’enregistrant que la croissance marchande (et moyenne), sans tenir compte des destructions sociales, humaines et naturelles. Le 1° siècle du capitalisme a été l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité, cf Dickens, Balzac, Zola…
Vers 1850, la voie « thermo-industrielle » a été empruntée et la masse produite s’est considérablement accrue au détriment du patrimoine naturel (actuellement en Chine, la croissance coûte de 10 à 12% du PIB en destruction des écosystèmes, c’est-à-dire l’équivalent de ce qu’elle rapporte (évaluation du ministre chinois de l’environnement). Jusqu’à l’invention de la société de consommation, cette économie de croissance se heurtait aux limites de la consommation et connaissait des crises périodiques ; tous les 10 ans environ.
Aujourd’hui, notre richesse nous appauvrit, car elle est fondée sur l’avidité et la compétition (l’élimination) d’un grand nombre de « perdants ». Aujourd’hui, il faut travailler moins pour vivre mieux, consommer moins, mais mieux, produire moins de déchets, recycler plus, inventer la félicité dans la convivialité et non l’accumulation frénétique.
Nous avons beaucoup d’initiatives « décroissantes » et solidaires : Amap, SELs, jardins partagés, auto-réhabilitations de logements, autoproduction assistée (jardins, cuisines, réparations…), le mouvement des villes en transition (né en Irlande à Kinsale)… Un plan de reconversion massive s’impose avec la réduction importante du temps de travail imposé. Il faut se réapproprier l’argent, relocaliser et se réapproprier son territoire.
Le Tao de la décroissance
« Est riche celui qui sait qu’il possède assez. » (Lao Tseu). La voie, c’est le Tao de Lao-Tseu, le do du zen japonais, le dharma des Hindous et l’éthos d’Aritote ; c’est le retour de l’éthique et de la sagesse qui n’est pas la raison rationnelle et qui peut apparaître comme une folie ; ce n’est pas pour autant l’irrationalité. C’est avant tout un autre regard sur nous, le monde, un autre monde possible. Les maîtres à réfléchir et méditer sont notamment : Gandhi, Thoreau, Dewey, Tolstoï, Illich, Ellul, Castoriadis, Gorz…
La décroissance est un choix, celui de la simplicité volontaire, mais aussi d’une révolution économique et sociale, car elle ne se réduit pas à la résistance, la révolte et l’insoumission. Elle est le choix d’une société décente, c’est-à-dire qui n’humilie pas ses membres, qui ne produit pas déchet, la « common decency » d’Orwell, la décence commune, c’est d’avoir de la retenue, être attentif. Un monde décent n’est pas un monde d’abondance matérielle, mais un monde sans misérables. Un monde où trouvent place tous les mondes.
Pour Aristote, la politique ne se conçoit pas sans une éthique, car la politique qui se limite à une éthique est impuissante ou terroriste ; la politique sans l’éthique voit le triomphe de la banalité du mal. Il nous faut remplacer l’opium par l’otium, l’école, la scholé des Grecs qui désigne un ailleurs dégagé de toute préoccupation de survie, de travail, de marché, dédié au loisir actif, dans lequel le jeune append à maîtriser ses passions. Le rapport au savoir est lié au rapport au « s’avoir ». La décroissance est une paidéia, une éducation, une formation et non un nouveau formatage. Elle est une révolution, mais aussi une fête qui brandit le droit au plaisir ; elle est un art de vivre bien en harmonie avec le monde ; elle est une poésie et une esthétique, ainsi qu’une ascèse, car un exercice d’émancipation des prothèses techniques et un entrainement à l’autonomie. Elle passe donc par une résistance et une dissidence.
Notre société est devenue totalement soumise à la dictature des marchés financiers, à la « main invisible » de l’économie et aux lois de la technoscience qui mène au transhumanisme. Mais l’artificialisation du monde en vient aujourd’hui à compromettre l’identité de l’humain. Ce projet repose sur la vision pessimiste de la nature humaine de la tradition augustinienne fondée sur l’animalité de l’Homme. Face à cela, c’est une véritable rédemption technicienne qui nous est proposée dans la fuite en avant ; c’est en même temps le rejet de la condition humaine. Et tout cela se fait sans débat démocratique.
Il nous faut abolir la foi dans l’économie, renoncer au rituel de la consommation et au culte de l’argent. Le développement n’est pas le nouveau nom de la paix (encyclique Populorum progressio), mais de la guerre, guerre pour le pétrole et les ressources naturelles. La paix passe par la décroissance ; il ne s’agit pas d’une société « parfaite », mais fondée sur la recherche du bien commun en lieu et place de l’avidité et la concurrence sans fin. La décroissance n’est ni une religion, ni une antireligion, mais une sagesse.